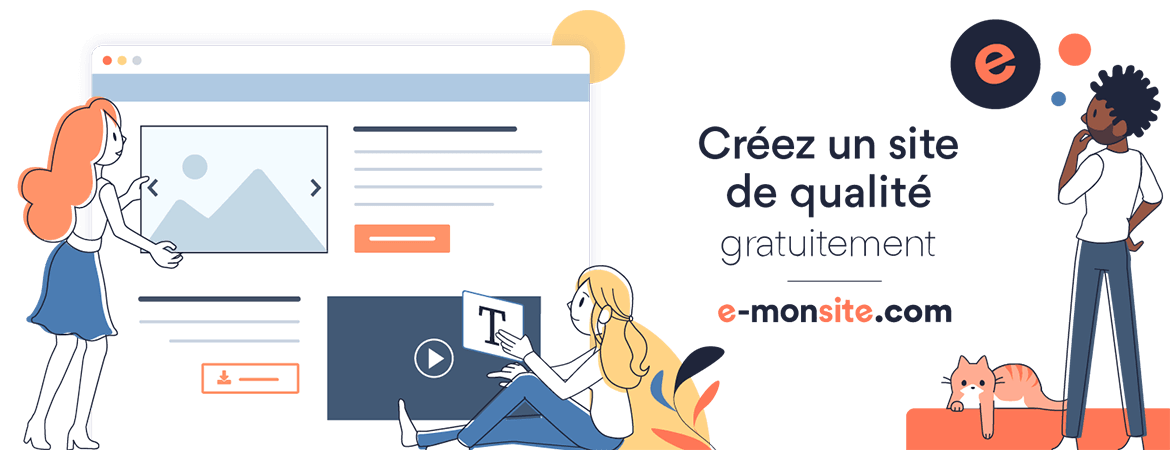Littérature
LES MÉDUSES N’ONT PAS D’OREILLES
d’Adèle ROSENFELD
D’emblée, le titre interpelle le lecteur : en effet, les méduses ne possèdent pas d’oreilles mais des organes sensoriels orientés vers la sensibilité visuelle et l’équilibre.
Louise, l’héroïne du roman est le double littéraire de l’auteur qui connaît les mêmes problèmes auditifs sévères « La bande-son est coupée » avec « le sentiment de n’appartenir à aucun monde » « pas assez sourde / pas assez entendante ». Une oreille totalement atteinte de surdité et l’autre en proie à un déficit important. Elle cherche d’autres signaux que celui du son. La lumière, dont il est souvent question, est la grande alliée ; elle permet de lire sur les lèvres, comme si le volume sonore augmentait brusquement « Je suis restée / à retourner ma chair vers le silence » « à la tendre comme une toile vers la lumière ». Le langage se retrouve troué et il faut sans cesse reconstituer les mots, les phrases qui demeurent bien souvent lacunaires. « J’avais l’habitude de divaguer dans les silences et les mots perdus » « Étrangère, je l’étais. Déracinée du langage ».
Mais pouvoir se déconnecter, fuir les déferlements aigus, les vrombissements, les frottements tectoniques, les halètements et retrouver la rondeur du silence…est-ce un vide ou bien un plein ? « La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer le silence » (Miles Davis).
Hormis les séances d’orthophonie, une intervention est proposée à Louise : un implant cochléaire, opération irréversible qui aura pour effet de lui faire perdre le peu d’audition « naturelle » qui subsiste au profit d’un son étrange et métallique avec, ensuite, une période de six mois à un an de rééducation. Le dilemme réside dans ce choix qu’il lui faut affronter comme un deuil. Louise a déjà fait abstraction d’une partie de sa vie puisqu’elle n’a pas de souvenirs du monde avant son appareillage, à l’âge de cinq ans. Le son serait-il nécessaire pour activer la mémoire ?
Toutes les questions posées par rapport à la norme se trouvent essaimées dans ce premier roman d’Adèle Rosenfeld, d’autant que, dans le cas présent, le handicap n’est pas décelable à l’œil nu « dans une marge invisible ». Vouloir tout simplement s’inscrire dans le quotidien devient une véritable gageure et toutes les personnes concernées par un enjeu d’une telle « résonance » seront immanquablement « à l’écoute » de ce livre-miroir multi-sensoriel !
Marie-Christine GUIDON
N.B : cet ouvrage a été traduit dans plusieurs langues depuis sa parution.
Éditions GRASSET
61. rue des Saints-Pères
75006 PARIS
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LA COLLECTIONNEUSE DE MOTS OUBLIÉS
De Pip WILLIAMS
1901. Alors que la première édition du « Oxford English dictionary » est en cours d’élaboration, Esme, fille unique et orpheline de mère, passe son temps dans le sillage de son père. Ce dernier est lexicographe dans le Scriptorium d’Oxford, familièrement appelé le « Scrippy », sous la direction de James Murray. « Scriptorium. À entendre ce mot, on imagine un édifice grandiose…Or ce n’était qu’une cabane, au fond du jardin d’une maison ».
La fillette passe le plus clair de son temps sous la table de tri des définitions et citations. Passionnée et curieuse, un jour, elle chaparde l’une des fiches où figure « Bonne à tout faire », sans en saisir la signification précise. Elle cache son butin dans la malle de son amie Lizzie, employée de maison chez les Murray. Esme constate rapidement que bon nombre de mots sont écartés du dictionnaire dès lors qu’ils concernent les femmes, leurs droits, leur quotidien. Elle décide alors de les sauver de l’oubli avec beaucoup de ténacité. En découvrant leur sens, tel que « flux cataménial », elle apprend les subtilités de la vie de femme et gomme peu à peu l’opacité qui entoure le registre lexical.
Le cœur gros, elle quitte sa région pour intégrer une institution de jeunes filles en Écosse afin de suivre des études. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle n’évoque jamais, dans ses lettres à ses proches, les mauvais traitements qu’elle subit en pension. Son refus d’y retourner après l’été et sa mélancolie durable finissent par alerter sa famille « tes lettres, à bien y penser, étaient trop parfaites ». Elle intègrera finalement le scriptorium en qualité d’assistante rédactrice, ce dont elle avait toujours secrètement rêvé.
Ce roman croise l’histoire des suffragettes, brossant un tableau éloquent de la société anglaise étriquée de la fin du XIXème – début du XXème siècle puisque le récit s’étend de 1887 à 1928. À cette époque, les femmes n’obtiennent pas de diplômes, n’ont pas accès aux bibliothèques universitaires, n’ont pas le droit de vote et sont souvent reléguées à des tâches subalternes. Bien des questions relatives à l’intimité et à l’intégrité féminines sont dénoncées au fil des pages (avortement, liberté sexuelle…).
Le premier dictionnaire d’Oxford est rédigé et financé par des hommes. Les femmes qui, de près ou de loin, y participent, n’en tirent aucune reconnaissance. L’ouvrage qui deviendra la référence pour la langue anglaise est le fil conducteur de ce roman dont l’histoire va bien au-delà des mots oubliés !
L’auteur, Pip Williams, a écrit des articles de voyage et de la poésie avant ce premier roman, acclamé unanimement par la Presse et les lecteurs à sa sortie au point de devenir un « best-seller » international. Il prend, à bien des égards des accents de révolte, d’une farouche détermination mais il est, aussi, empreint d’une vive émotion et d’une grande humanité…
Marie-Christine GUIDON
Fleuve Éditions
92, avenue de France –75013 PARIS
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ISSUES PROVISOIRES D'UN DEVENIR
de Jacquy GIL
Cet ouvrage en prose poétique d’une intensité qui force le respect, a été récompensé par le Prix d’Estieugues 2024 à Cours la Ville (Éditions La licorne). L’auteur avait déjà obtenu ce prix en 2010 avec un recueil intitulé « Labyrinthes familiers ». Comme le souligne Gilles Cherbut dans sa préface en évoquant Jacquy Gil, « rien d’étonnant à cela, tant sa parole est singulière, puissante sa pensée et vigoureux son propos ! ».
Le poète nous entraîne sur des chemins de partage où la prise de conscience vient interpeller le quotidien, avec une éloquente simplicité. Des échos incantatoires et de sagesse se tissent entre les lignes, entrelacs de raison, d’humanité et de grâce. Chaque aurore est un recommencement sous la plume du poète. Chaque étonnement est une fulgurance. « cela peut se traduire par une insignifiance, un fait quelconque, sans envergure » « Mon pouvoir est de puiser à même ma conscience, de donner des yeux à mon devenir ».
Sur le mur bien lisse des certitudes, les anfractuosités se profilent à mesure que l’œil s’approche de la réalité et « Les deux versants de l’impondérable » se dessinent alors. Réalisé et réalisable se mêlent pour devenir le bivouac du quotidien, celui « de nos solitudes ». À la lueur du passé, du présent, notre futur s’écrit en lettres de mystère « nous accaparons les signes et les perdons en nous-mêmes ».
Jacquy Gil est habité par une foi sans bornes envers ceux qui lui font face, ses semblables « Oui, j’avoue mon trop de pages, mais l’homme, oh non jamais, je me défends de l’avoir trahi ! »
Rien n’est figé, tant les couleurs du ciel de l’humain peuvent passer de l’ombre à la lumière ou inversement. La lucidité de l’auteur s’habille parfois de désenchantement « Et l’on dira de son silence épiphane : cela était écrit, ceci devait arriver… »
Il affronte les vicissitudes du monde avec pour seule arme sa vaillance et sa plume. « L’homme s’y plaît et s’y jette à cor et à cri ». Pourtant, la retenue est de mise pour celui qui tend à s’effacer par nature. Pour avoir croisé sa route poétique, cet homme-là n’est pas ordinaire du tout, car pétri d’humilité et de générosité, chose plus qu’inhabituelle de nos jours !
Son œuvre serait-elle un immense point d’interrogation, tant les questions qui le taraudent sont nombreuses et profondes ?
Et de garder toujours à l’esprit qu’« On ne boit pas au vent comme on boit à la fontaine » !
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
TRAVERSER L'OBSCUR
de Michel DIAZ
Éditions Musimot
Couverture et illustrations : photographies de Marie-Pierre Forrat
Une nouvelle fois, Michel Diaz nous chuchote à l’oreille avec ce dire si particulier dont il a le secret, les mots fécondés par un souffle : respiration, palpitation malgré l’obscur, les cendres, tout ce qui pèse. Dans cet opus méditatif, préfacé par Jean-Louis Bernard, plusieurs saisons se déclinent « en un temps qui ne sait que durer » criblant le ciel d’incertitudes : 1. « Leçons de ténèbres / 2. Comme une porte au vent / 3. L’ombre dissout les pierres / 4. Être là ». Et évoquant les aubes de papier cueilleuses de mots, les premiers mots, ceux de l’enfance, du jour qui vient. Et toutes les aubes qui suivront, petits grains du cycle immuable de l’infini, là où le grand et l’invisible ne font qu’un tout, un et indivisible. Dans le feuilletage des années, dans ces strates du temps s’écrit notre histoire. Pourtant, « on voudrait / déchirant ses ombres / répondre seulement répondre / au mystère insondable de l’univers / aspirer rien qu’une seconde une bouffée d’éternité ».
Faire vibrer la page blanche en y déposant ses pensées, ses meurtrissures est la plus signifiante façon d’habiter son passage en ce monde « La nuit, te disais-tu, est le seul mot que rien n’érode, l’espace d’une errance aux obscures frontières ». Sur la pierre est gravé l’invisible : la douleur qui ne dit pas son nom… jamais !
L’obscurité nous oblige à marcher en faisant abstraction de nos repères, ce qui révèle nos failles, nos doutes. Mais elle nous permet dans le même temps ce regain d’attention, tous nos sens en éveil jusqu’à percevoir l’invisible, entendre l’indicible tandis que dans « la bouche quêteuse de la moindre lueur d’aurore, quelque chose pleure dans l’air ».
Traverser l’obscur, n’est-ce pas, malgré tout, s’exposer à l’éblouissement ?
Clarté, obscurité : deux faces indissociables d’un astre. Il en est de même dans ce recueil, où plusieurs voix s’invitent dans l’écriture, revêtant des visages différents, un dédoublement du poète dont les pensées se font face… un écrit spéculaire !
La parole saignant à vif sur les mots qui se brisent aux racines du souffle ne sait sous quelle forme s’énoncer et cela semble précisément l’enjeu de cette démarche poétique… entre « prières et suppliques », entre « musique ou incendie », il nous faudra choisir l’ « accord profond d’un coup d’archet… et faire vibrer la lumière qui veille sous le sang des nuits ».
La flamme, même si elle semble vaciller parfois, permet de faire la traversée. Elle devient alors plus précieuse et prend des allures d’étoile dans la longue nuit qui nous entraîne à poursuivre encore et encore. Sa modeste lueur ne permet pas d’éviter les obstacles mais buter « contre un mur », éveille la conscience et donne tout son sens au cheminement vers le Soi.
L’errance, ne serait-ce pas ce chemin jalonné de petits cailloux blancs qui nous permet de retourner à notre essentiel, puisque bien souvent « on avance ne laissant nulle empreinte … marchant sur des mots morts… foulant la terre obscure » ?
Encore faut-il retrouver la « parole du poème / quand la vie trébuche / et ne sait plus arracher l’ombre / à la nuit de nos pas ». Quelle aide plus précieuse alors que celle des mots ? Mais il faut s’essayer à l’expérience des confins, des limites entre prose et poésie, entre récit et chant, entre fiction et mémoire, énigme et évidence, pour apprendre que « de l’eau claire des sources » peut jaillir « un calme souvenir d’enfance » ou plus simplement « le seul bonheur d’être »…
Michel Diaz nous incite dans cette traversée à nous fondre « au plus intime du silence » en cheminant à ses côtés.
Marie-Christine Guidon
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
CROIRE
Sur les pouvoirs de la littérature
de Justine AUGIER
Cet ouvrage a germé dans l’esprit de l’auteure lors du premier confinement « dans un temps d’enfermement et de suspens ». Puis la vie a repris son cours et le livre est resté à l’état de projet à cause de ce que l’on peut qualifier de fatalisme, jusqu’à l’hiver suivant.
Justine Augier, intellectuelle voyageuse, désireuse de s’émanciper en trouvant sa propre voie, engagée dans l’humanitaire depuis 2001, nous livre alors un récit intime : celui de l’engagement…envers la littérature et sa mère, Marielle de Sarnez, décédée d’une leucémie en janvier 2021. « Il faut que tu l’écrives, ce livre sur la littérature et ses pouvoirs » lui avait-elle demandé. « Quoi qu’elle ait à raconter, quelle que soit sa forme, la littérature défait ce qui enferme ».
Des fils se tissent au gré des pages et le canevas prend forme : ce qui rapproche mais aussi ce qui sépare, tout ce qui compose des liens indéfectibles et puissants entre deux êtres, presque une conversation malgré l’absence « le deuil pousse à établir partout des liens ». De nombreuses références aux lectures partagées pour retourner à l’essentiel « La littérature redonne au temps sa texture, l’épaissit, convoque les fantômes, ceux d’avant et ceux qui viennent, et cette conversation…demeure pleine d’espoir ».
L’intime et le politique se trouvent mêlés puisque chaque chapitre débute par une évocation de Razan Zaitouneh, avocate Syrienne, engagée contre le régime en place et exécutée à l’âge de 36 ans, en 2013, par un groupe islamiste « nombreux étaient ceux qui voulaient à tout prix éradiquer son insupportable rectitude » et notamment « ce qu’elle incarnait de possibles et de promesses ».
Que perçoit-on vraiment des cris d’alarme qui fusent aux quatre coins du monde ? Comment raconter simplement les derniers moments entre une mère et sa fille, le deuil, le chagrin ? Dans un cas comme dans l’autre, écrire pour ne pas oublier ce que le temps, inéluctablement, tente de gommer, ne pas « laisser les fantômes se faire embaumer et devenir froids ». L’obscurité existe, on ne peut l’ignorer ; les écrivains ont pour mission de trouver une nouvelle posture : absorber le négatif ! « Il nous faut retrouver le pouvoir perdu de la langue ».
Les citations essaimées tout au long de cet essai nous font découvrir l’éventail des auteurs qui peuplent le panthéon de Justine Augier. « Le silence auquel éduque la lecture est poésie ».
« Croire sur les pouvoirs de la littérature » nous confirme combien les mots ont cette capacité à changer les choses « j’ai récupéré en l’écrivant un peu de cette substance que je nous dois de laisser se répandre et déborder ».
Marie-Christine GUIDON
Contact : Éditions ACTES SUD
Le Méjan
Place Nina-Berberova
13200 ARLES
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Sous l’étoile du jour
de Michel DIAZ
Rosa Canina Éditions publie principalement des écrits poétiques ancrés dans le vécu et cet ouvrage préfacé par Alain Freixe en est la vibrante démonstration. En effet, dans le recueil de Michel Diaz, « s’évide le poème aux limites d’un cri »…
Les pensées peuplées de failles et de déchirures, se dessinent et s’enroulent, s’apprivoisent et se dérobent « sous l’étoile du jour ». Le chemin d’exil qu’emprunte l’auteur est souvent éclairé de « la flamme obscure des confins ». Dans une « marche qui défie le vide », il évoque son « jardin perdu » avec une « douloureuse nostalgie ». Il va puiser aux racines ce qu’il subsiste de sève pour résister encore.
Telle une étoile filante, venue d’un horizon lointain, « royaume défunt », Michel Diaz se risque à chercher « dans l’ombre des pierres », « entre allégresse et désarroi », une aube prometteuse « juste pour éprouver comme un sentiment d’avenir ».
Sa plume sublime le prosaïque et pétrit le verbe avec une puissance démiurgique. Il écrit « pour donner vie à tout ce qui n’est pas, et chair à l’invisible » poursuivant inlassablement sa quête éperdue sur des sentes jalonnées de solitude, de poussière et de cendre, nous laissant face à une « phrase inachevée sur le blanc du papier » mais les yeux rivés sur un lointain, un possible à réinventer...
À cette heure où tout n’est qu’impermanence et incertitude, Michel Diaz, à n’en pas douter, écrit « un canif enfoncé dans le cœur » !
Marie-Christine Guidon
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
CLAPOTILLE
de Laurent PÉPIN
Après Monstrueuse féerie (2022) et L’angélus des Ogres (2023), Clapotille est l’ultime volet d’un triptyque de Laurent Pépin, psychologue clinicien de profession et écrivain. C’est un âpre combat que de rester debout, comme celui d’écrire, « tout conte fait » !
Dans ce voyage en « décompensation poétique », l’obscur côtoie le lumineux. L’onirisme rivalise avec les monstruosités reptiliennes qui étreignent insidieusement. La féerie et les cauchemars peuplent alternativement cette traversée du miroir, en mouvements oscillatoires incessants… flux et reflux porteurs d’écume.
Le narrateur nous invite à partir à la dérive, laisser le fluide poétique pénétrer tous les pores de la peau, nous immerger dans ses doutes, jeter les vieux a priori, devenus guenilles inutiles sans craindre de couler pour vivre une aventure spéculaire inédite !
Laurent Pépin, explorateur des abysses du cerveau humain, griffe de petits signes noirs, avec une folle application, la page blanche des jours à venir et les met sur orbite pour que chaque lecteur se les approprie. Il nous fait « faire des aller et retours entre les mondes imaginaires et notre médiocrité désenchantée ». En nous faisant découvrir le sens caché de ses maux, il s’évade de manière déconcertante des vérités jugées inébranlables, des principes indéboulonnables pour aller puiser aux racines de son être, l’Essentiel… Un parcours initiatique, vecteur de métamorphoses surnaturelles et chargé de symboles qui nous réveille et nous révèle à nous-mêmes « Tu veux devenir un personnage de conte ? Chiche ! Tu ne regretteras pas le voyage… »
Clapotille, mirage salvateur, dont le nom, à l’oreille, pétille, a cette particularité, avec sa grâce opératique, de nous entraîner au pays des fables fertiles pour faire vibrer en chacun de nous une part d’humanité effervescente … Clapotille n’est qu’un être éthéré, née d’un dessin dans la neige. Lucy, sa mère morte, existe désormais sous la forme d’un trait unaire, référence lacanienne par excellence. La fillette a vocation à apaiser, sinon guérir, les peurs et les obsessions du narrateur « je suis la seule à pouvoir le soigner ». Mais, comme souvent dans les contes, les Monstres surgissent des profondeurs de l’Enfance, fantômes poisseux. Ils s’évertuent si l’on n’y prend pas garde, à venir éteindre la moindre petite étincelle, la fragile lumière qui vient nourrir le jour qui point. « Les souvenirs cassés, ce sont les souvenirs que l’on rejette et qui se changent en trous noirs ». Ces briseurs de rêves ne connaissent aucun répit et ils traversent impunément l’espace et le Temps, se repaissent de notre futur en gestation. Voir disparaître les chaînes, les hallucinations, les peurs scarifiées, la claustration, le tout balayé par un furieux vent d’hiver… et enfin découvrir un tapis blanc et cotonneux, semblable à « un rêve-à-aimer-sans-y-penser » pour permettre à Clapotille et Antonin, les amoureux des limbes, de suivre un nouveau chemin !
Dans ce « conte à rebours » renversant, « L’ouverture » met un point final à la composition lyrique de l’auteur…
Ne s’agit-il pas là, d’une démarche héliotropique positive vers une éclosion nouvelle puisque Laurent Pépin échappe à tous les poncifs et apprivoise un univers métaphorique totalement acquis à sa cause et son talent, guidé par une impérieuse nécessité d’écrire !
Marie-Christine GUIDON
Contact : Éditions Fables Fertiles
18, rue de la Marne
95460 EZANVILLE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Souvenirs de la maison de l’aube
de Guylian DAI
L’épigraphe extraite de « L’Enfer » témoigne de la conception géographique dantesque du récit de Guylian Dai. Sous forme d’offrande, l’auteur nous conte le périple initiatique d’Ilhan Jung. Le récit débute et se trouve porté au fil des pages par un rêve, axe central de cette aventure humaine singulière et souffle vertigineux d’un changement annoncé... le moment crucial, le point de bascule « Figé tout au bord d’une haute falaise… C’est ici que je dois basculer ». De ce songe obscur, naît le point de non-retour, une quête inscrite en filigrane, tandis que se mêlent l’imaginaire et le réel pesant d’un quotidien banal. C’est pourtant de cette parenthèse, teintée de tristesse et d’incertitude, que s’élève le « chant » de tous les possibles… « Les livrées ombragées de mon rêve m’ont tendu une réponse ». S’ébauche alors un « déluge d’intuitions » parmi les « lueurs brouillardeuses ».
Malgré un rappel à la réalité dû au radio-réveil, Ilhan Jung est encore drapé dans les vestiges nocturnes ; il retarde le moment de se rendre à son travail et chose inhabituelle coupe son téléphone « le je de déraison, que je sais si bien contenir d’ordinaire, en vient à se dégager ». Il ne répond plus aux messages laissés par son responsable Marc Leutorc et sa collègue Jasmine Paul. L’esprit d’entreprise, où la rentabilité, à tout prix, rivalise avec la superficialité des relations, lui est devenu insupportable. Il dresse, d’ailleurs, un portrait sans concession de ce théâtre facétieux.
En se rendant au supermarché, il fait une curieuse rencontre, celle d’Auguste, personnage hors du commun, à de nombreux égards et haut en couleurs, qui attise sa curiosité de par son mode de vie marginal au regard de la société et de l’ordre établi. Un curieux dialogue s’instaure entre ces deux êtres dissemblables, a priori « Ô âmes tourmentées, venez nous parler, si nul ne le défend ! » lance l’homme citant L’Enfer de Dante.
L’auteur laisse son empreinte poétique dans son cheminement erratique, traversé par le doute, la solitude. La « terra incognita » où il fait peau neuve devient propice à l’éveil et fertilise l’indicible, l’invisible « mon rêve est ce parage qui s’attarde tel un proche… je peux bien lui accorder bénéfice ».
Midi… L’insert poétique d’Ondine Valmore donne le ton de la pause méridienne que s’accorde le narrateur. Loin de l’agitation, Ilhan émiette le temps, rejoint bientôt par son « Bel oiseau », jadis blessé et soigné par Elmina, la grande absente ; ils picorent ensemble l’instant suspendu dans le jardin du souvenir.
S’alléger des contraintes, gommer les injonctions, savourer chaque seconde, retrouver tout simplement sa part d’enfance, redevenir « petit garçon », s’adonner aux flâneries dans un éloge de la lenteur devenu précieux. Ainsi, le répit devient salvateur et va pouvoir s’étirer dans le « processus d’une lente ressaisie du monde ».
Mais les souvenirs font irruption dans le présent et en bousculent la temporalité. Parfois, ils sont élimés comme de vieilles photos jaunies, parfois, ils s’enrichissent et finalement plus on les convoque, plus ils mûrissent au point de prendre le pas sur le réel. Avoir des souvenirs, c’est avoir une histoire, c’est être vivant… avoir des souvenirs, c’est se sauver de l’oubli ! « Le réel ne se mesure pas à ce que l’on peut toucher ».
Anna, venue dîner, s’inquiète pour son père, à l’idée de le voir replonger dans l’abîme de la dépression. Lors de cette visite, elle surprend un échange entre ses parents, Ilhan et Elmina. Même si son père est conforté dans ses choix après cette discussion, Anna reste sur ses gardes. Elle craint plus que tout, les « boucles obsessionnelles, voire délirantes » qui peuvent assaillir son père. La trajectoire suit la ronde imperturbable des aiguilles sur le cadran, ouvrant sur une densité lucide, vivante et douloureuse de la mémoire. En reliant le passé de ses souvenirs avec le présent de leur évocation, le narrateur nous offre une puissance troublante des émotions qui l’animent. Pour suivre sa voie, le pèlerin se déleste des bagages devenus encombrants. « Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel ; il nous faut tous les mots pour le rendre réel. » (Paul Eluard).
Avec son témoignage éloquent, miroir d’une intériorité où le regard du lecteur est immergé, Guylian Dai, donne la parole à ses interrogations et nous fait prendre conscience des nôtres. En épousant la « voix » de la métamorphose à la force de ses mots, il redessine un univers porteur d’espérances nouvelles et fertiles.
Bien au-dessus de l’abîme, se trouve un arc-en-ciel… qui sait ?
Marie-Christine GUIDON
Contact : Éditions Fables fertiles
18, rue de la Marne
95460 Ézanville
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
DES NOUVELLES DE LEDA ?
de Catherine ANDRIEU
« Fermer, ouvrir – Le bal des mots dits de Catherine Andrieu », tel est l’intitulé de la préface de Jean-Paul Gavard-Perret qui résume l’authenticité touchante de cet opus. Une huile sur toile révélatrice « Léda peint le Cygne » de l’artiste Anora Borra illustre la couverture… « Léda ne peint rien du tout, le cygne, c’est elle » !
S’ensuivent plusieurs témoignages qui, d’un large éventail de qualificatifs, nous brossent un portrait de la poésie fantasmagorique et picturale de l’auteure. Cette anthologie, reprenant des textes récents, comporte également deux inédits « Le portrait fantasmatique d’Anora Borra » et « Des jours et des lunes ».
L’ouvrage est un véritable puzzle où imaginaire et réel se mêlent, se heurtent… où les pièces manquantes restent à découvrir. De l’irrésolu naît le vrai, le profond, le ressenti, indissociables du cheminement passé, présent et sinueux, à venir. Perdue dans l’opacité d’un espace-temps qui n’en finit pas de durer, Catherine Andrieu se livre sans faux-semblants, solfiant les événements douloureux de son existence, intensément, de sa plume exacerbée. Rester debout face aux jours inaccomplis, entre « l’été de Haydn » et « l’impromptu de Chopin », apprivoiser quelques mesures qui ne se mesurent que sur l’échelle des émotions, apprendre à survivre avec « l’ignominie du temps qui dévore les enfants », accepter de vivre avec les vicissitudes, l’improbable, la dramaturgie que la vie nous impose comme dans le théâtre antique… Alors que dire des flots tumultueux qui frappent inlassablement la digue, ce rempart érigé pour affronter les tempêtes infanticides ? Les écrits de Catherine Andrieu sont porteurs de béance, de cicatrices « Il y a la cruauté pourtant, et l’érotisme parfois morbide, mais l’on sait depuis Freud que l’enfant est un pervers polymorphe ! »
Tout ce que la terre porte en ses profondeurs sibyllines de noirceur et de cendres ne se transforme pas en feu d’artifice, c’est une évidence ; même si nous sommes emprisonnés dans une cage obscure il reste possible d’attraper quelques lucioles dans le secret des nuits étoilées, une forme d’accomplissement.
Les chats, Paname et Lune, astres bienveillants, générateurs d’amour inconditionnel illuminent d’ailleurs les pages de leur présence… les chats, synchronicité entre réalité et mutations du désespoir. Survivre, un enjeu capital, entre entraves et entrailles, quand parfois les touches du piano si cher à l’auteure, deviennent silencieuses. Pour autant, la solitude est terreau de création par excellence. La poésie onirique devient alors radeau, de ceux qui sauvent d’espoirs évanouis, des bois flottés sur un océan d’errance… une autre façon de revoir sa grammaire et son passé décomposé « Je suis une femme qui écrit. Ce que je ne suis pas ? Une personne engluée dans la matière »
Radicalement novatrice, Catherine Andrieu nous entraîne dans sa trajectoire cosmique au son de ses voix, des vibrations de sa musique intérieure, tempo effréné de son ressenti et puissance de son souffle !
Editions Raphael de Surtis
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
SÈVE NOIRE POUR VOIX BLANCHES
De Jean-Louis BERNARD
Découvrir ce recueil de Jean-Louis Bernard, c’est tout simplement entrer en Poésie, se laisser entraîner par son souffle élégiaque, se laisser porter par sa voix pénétrante qui nous ouvre, en ombres d’encre, des espaces non cartographiés, traversés d’insolites tombées de lumière. Mais c’est aussi « Puiser dans l’archipel d’oubli » entre cendres et craie puisqu’il nous est donné de vivre « la vérité du jour » et ses « vestiges incandescents ». Qu’importe le temps, le chemin se déroule en un long ruban semé de volutes poétiques « à la lisière de l’écume et de la braise », « entre mystère et inutile / errance assourdie » et « éloge du vertige ». Les mots jaillissent avec fluidité comme une évidence guidant nos pas vers un éveil spirituel.
Noir et blanc, indissociables, l’un étant le miroir de l’autre, tels le yin et le yang, symbolisent, Ô combien, la complétude. L’auteur, nous invite par le biais de l’oxymore, à la calligraphie en éclairant « la blanche ténèbre » de sa « flamme obscure ».
Entre ici et ailleurs, les frontières sont poreuses. Dans la fragilité de l’instant et les « Fragments de brume », « un filament de lymphe entaille le ciel / certains le nomment nuage ». Derrière la mouvance des émotions suggérées, une interrogation affleure « que reste-t-il à peindre quand le silence est advenu » et l’on devine que « sous le silence germe la douleur ». En filigrane s’inscrit l’absence ; le cri alors devient muet, « la chouette verse une larme de verre » et dans cette déréliction, « le jour s’inaccomplit ».
Jean-Louis Bernard nous offre ici des poèmes empreints d’échos incantatoires « pour que nous puissions réconcilier l’évidence et le mystère » et comme il le souligne « désapprendre le point final nous prendra une vie ».
Marie-Christine GUIDON
Contact : Jean-Louis BERNARD
4, boulevard du Maréchal Foch
38000 GRENOBLE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ÉLOGE DES EAUX MURMURANTES
Michel DIAZ
Illustrations de Lionel BALARD
Cet « Éloge des eaux murmurantes », aux images évocatrices, est une véritable invitation à un voyage onirique, dont on ne sait où il nous mènera…Nous confions, alors, notre périple en pays poétique à Michel Diaz, poète habité par un chant de longue haleine. Lionel Balard, artiste plasticien et graveur, prête sa plume différemment, à ce très bel ouvrage avec la création de xylogravures, illustrant de façon magistrale ce livre d’art. Cette complémentarité est à l’égal de celle entretenue, de la première à la dernière page, avec la Nature. Le voyageur se laisse happer « dans l’évasement de son souffle, vers cet inconnu qui l’attend, la trajectoire du poème »…
Dans le friselis de l’onde et le suintement des pierres aux lèvres humides, l’eau serpente, ruisselle aveuglément. Elle s’abandonne, alanguie, caressant le velours moussu, comme des larmes sur les joues d’un enfant « eau restreinte qui suit son tracé reptilien ». L’eau porte en elle un flux de mots invisibles, lien secret au cœur de l’élément liquide, élixir de toute vie « parole imprononçable encore mais constante » de « ce qui nous est plus intime, et que nul ne saurait nommer ». Aux entrailles des rivières, dans le limon fertile, naissent au fil de l’eau, les perles d’un temps suspendu et fragile, battements furtifs…en un ballet aquatique impérieux, des herbes éprises d’une liberté farouche dansent au gré d’un courant capricieux. Mais, dans les méandres, s’accroche la mémoire…c’est là, au creux des « échos sourds de l’eau » que murmurent les « voix disparues ».
La fugacité des reflets changeants, qui s’offre à nos regards vient troubler nos certitudes et aiguiser nos sens endoloris comme une respiration à deux temps entre hier et demain, abandon et conscience, pénombre et lumière, silence et cri « souffle des mots sur la peau palpitante de la lumière ». Dans le long cheminement du poème, la métamorphose s’accomplit « glissement d’une navigation très lente dans les veines ». Les écailles des heures apprivoisent patiemment les eaux troublées de l’enfance « Le temps se réinvente ». Chaque seconde porte en elle l’éternité, là où les lendemains chantent en quête de clarté « à travers l’âpreté des jours et l’improvisation de son tracé, creusé d’orages et de pluies ».
Lorsque tout se tait, que la blessure s’apaise, seul, émergeant du silence, s’élève un chuchotis, ce chant incantatoire qui chavire la pensée nomade « Territoire de solitude » « ce lieu d’incertitude où germe le poème » !
Éditions LA SIMARRE
JOUÉ-LÈS-TOURS
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LE NAIN DE WHITECHAPEL
Cyril ANTON
Éditions du Sonneur
Ce récit surréaliste d’une originalité déconcertante et d’un réalisme criant dévoile un personnage atypique, « le nain de Whitechapel ». Avec l’incipit « Les hommes sont les ombres dans lesquelles ils tombent », Cyril Anton nous entraîne dans un voyage qui n’est pas sans rappeler « Le voyageur et son ombre » de Nietzsche.
Oscar Swinburne voit le jour dans une famille bourgeoise de la fin du XIXe siècle, précédé d’une heure par son frère jumeau Vincent… mais Oscar est atteint de nanisme alors que son frère répond aux standards de la normalité. La grandeur d’une âme ne vaudrait-elle pas celle d’un corps, fût-il parfait ?
Complicité et malice unissent les deux garçons qui sèment la zizanie parmi leurs professeurs : escrime, équitation, piano classique... Oscar, objet de honte pour ses parents en raison de sa différence, devient, jour après jour, leur souffre-douleur. Et « comme s’il avait le pressentiment qu’un drame allait survenir dans sa famille », après des années d’humiliations et tant de talents innés devenus peu à peu sans importance, il est abandonné aux affres de la solitude, littéralement jeté aux chiens dans le Londres glauque de cette époque, où règnent violence et misère « autant dire nulle part, en bord de mort, sur les quais du grand Peut-Être ».
Le chagrin est un habit dont on ne se défait pas si facilement !
En proie à l’incertitude, il est finalement acheté et recueilli par Freddy… un vieil homme noir avec « la musique dans la peau » qui répare d’anciens pianos et dont l’instrument de prédilection le « Lisa » ne vibre plus de la même façon depuis la mort tragique de sa compagne. Il affuble Oscar de surnoms tels que Half-Pint, Little Lord, ou encore, Demi-portion. Voyant des dispositions chez sa jeune recrue, il lui fait découvrir autre chose que la musique classique : le Jazz et la « blue note », « le truc bleu du vieux noir ! ». La note bleue, irisation sonore, cristallise les « Blue devils », idées noires nimbées de nostalgie qui se posent sur la portée des jours, délivrant un supplément d’âme et d’expressivité à l’histoire de ce clochard céleste, surgi des bas-fonds, au son peut-être, de « Born to be blue » de Chet Baker, version piano… « Les notes sont des oiseaux qui volent dans le lointain et gomment nos lointaines souffrances ».
Un terrible gang « Tabula Rasa » sévit à Whitechapel et traque la communauté des gens différents, considérés comme des rebuts de la société, « tout le peuple de l’ombre » : les handicapés, les homosexuels, les prostituées, les noirs, les juifs… Un soir, Oscar retrouve Freddy sauvagement assassiné par le gang exterminateur. Mais, « son nanisme lui avait inculqué une hauteur de vue et une maturité peu commune ». C’est alors qu’il met au point « une colossale boule à neige » semblable à celle qu’il tenait dans ses mains, enfant. Cette bulle protectrice, où solidarité et joyeux désordre font partie intégrante du décor, est destinée à protéger le quartier et ses habitants du fléau sanguinaire qui menace. La rage au cœur ne connaît aucun répit et c’est ainsi que s’exprime le lyrisme flamboyant d’un écorché vif ! Sans fards, la lucidité nous éclate au visage. Oscar devenu Octave Dièse ne compte plus les bémols de sa triste existence « Son regard en disait long sur sa solitude ». Sur la tablature de sa destinée s’inscrivent à la fois l’indignation, la résignation, mais aussi, tant de dignité et de résilience. Dans le prolongement des blessures, les cicatrices et qui sait… la guérison ! « Lève-toi et mange » remémore, en contrepoint, le verset biblique « Lève-toi et marche ! ». Il suffit parfois d’un être pour illuminer l’obscurité « la fine dentelle du sourire de Rose suffit bientôt à éclipser tous ses cauchemars ».
La plume erratique de l’auteur nous fait pénétrer son univers singulier et son imaginaire foisonnant… Oscar, Octave : sensation troublante de flotter entre deux « O »… là, le monde s’étale en flaques qui viennent éclabousser le lecteur. La question se pose : Cyril Anton ferait-il usage, à l’instar de Fernando Pessoa de la création d’hétéronymes pour se raconter en disséminant de façon subliminale à travers ses personnages, quelques pièces de son propre puzzle ? Est-t-il utile d’ajouter que dans les yeux d’un auteur aussi (clair) voyant, les temporalités se fondent… hier et aujourd’hui enlacés !
Entre les lignes, tatouées de noirceur, où se mêlent rebondissements et révélations à un rythme soutenu, on se trouve face à un référentiel culturel allusif impressionnant. Profondeur et subtilité sont conjuguées à toutes les saisons de ce récit, une véritable composition synesthésique. À la lecture de ce premier opus de Cyril Anton, on ne peut faire abstraction de quelques réminiscences cinématographiques : Freaks de Tod Browning (1932), Elephant Man de David Lynch (1980) ou Sweeney Todd de Tim Burton (2007), même s’il en existe bien d’autres.
Le pathos, pour ceux qui l’attendaient, réduit en flocons de neige, n’entre pas dans la partition… jamais. « Ce qui nous pousse au moment où nous nous croyons perdus, c’est ce que nous sommes »… Cet ouvrage, aux accents spéculaires, expose nos consciences aux impacts de réalités dévastatrices… une poésie du désespoir, une beauté nue, à saisir !
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
UNE ROSE SEULE
De Muriel BARBERY
L’exubérance végétale dépeinte au fil des pages plante le décor de ce roman descriptif en composant une véritable estampe. Le récit est ponctué de petits contes porteurs de valeurs ancestrales.
Rose, quarante ans, botaniste, a entrepris pour la première fois un voyage au Japon, à Kyōto, plus précisément « elle était venue entendre le testament d’un père qu’elle n’avait jamais connu ». Mais elle peine à comprendre les intentions de son père défunt. En proie à une colère à peine contenue, elle se retrouve chez celui, qui, lui dit-on, était marchand d’art contemporain, Japonais d’origine. Elle est guidée par Paul, assistant de ce dernier, qu’elle interpelle « qu’est-ce que l’absence et la mort peuvent donner ? De l’argent ? Des excuses ? ». Jusque là « le vide gangrénait sa vie de la même façon qu’il l’avait engendrée » « comme on perd un mouchoir, elle avait perdu sa disposition au bonheur ».
Entre traditions et modernité, Rose apprivoise peu à peu les jardins Zen (ikebana) « leur pureté aiguisée de douleur, la manière qu’ils avaient de ressusciter les sensations de l’enfance ». Paul, veuf et très secret l’accompagne dans ses découvertes. Dans ce tableau où la poésie mouvante se conjugue aux images, tout semble presque figé, intemporel et de cette lenteur naît la précision d’une calligraphie inspirée par les fleurs « nous marchons en ce monde / sur le toit de l’enfer / en regardant les fleurs ». Rose se révèle à elle-même, ceinte d’une obi de quiétude, d’une forme de légèreté inhabituelle. Elle tente de dissoudre la réalité dans l’ensō, ellipse de sable ratissé, symbole de la vacuité et de l’achèvement dans le bouddhisme zen « Le monde s’était réfugié dans ce pan de sable et de cercle ». Son cheminement épouse le rythme de la nature « La vie n’est peut-être qu’un tableau qu’on contemple derrière un arbre ».
Pivoines blanches, hostas, brassées d’œillets rouge sang, azalées, magnolias engendrent une atmosphère lénifiante propice à la méditation et finalement à la métamorphose.
Entre temples, érables et bambous se dessine « un frémissement d’espérance » et avec lui l’éclosion d’un amour naissant et d’un possible futur.
Loin de toute pression médiatique, Muriel Barbery, nous ouvre la porte de la culture nippone qu’elle connaît bien pour avoir vécu au Japon et elle nous offre dans son bouquet final…une Rose épanouie !
Éditions ACTES SUD
Place Nina-Berberova
Le Méjan
13200 ARLES
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LA PATIENCE DES TRACES
de Jeanne BENAMEUR
Éditions Actes Sud
Un bol cassé : il suffisait de cette brèche dans le quotidien pour que Simon, psychanalyste, passe de l’écoute des autres à un parcours initiatique qui le conduit à faire le point sur sa propre vie. Lui, qui a consacré son temps à réparer les âmes brisées, va partir pour le Japon et plus précisément dans les îles subtropicales Yaeyama. Là, il sera hébergé dans une maison d’hôtes, par un couple bienveillant, Akiko et Dasuke. « la langue inconnue lui fait un abri » « Comprendre ou ne pas comprendre, cela n’a plus aucune importance ». Il lui faut chasser « la réflexion analytique, une seconde nature encombrante ».
Simon va fouiller dans son silence pour tenter d’entendre sa propre musique ; il va se libérer peu à peu de la gangue de ses regrets et en alléger le poids. Oser regarder avec lucidité les blessures du passé, les failles de l’intime pour trouver la force d’avancer, à l’image de la technique ancestrale japonaise du kintsugi (kin « or » et tsugi « jointure ») qui consiste à réparer les céramiques abîmées sans masquer leurs fêlures mais, au contraire, en les sublimant « c’est la nouvelle vie qui commence ». Il s’agit d’un cheminement vers une liberté intérieure, la bascule d’une trajectoire, instant essentiel soumis au hasard…une sorte de révélation mais « Pour la délivrance il faut toujours payer le prix ».
Dans l’économie de mots, la capacité d’écoute, une attention extrême, Simon se débarrasse de l’inutile comme on quitte un vêtement devenu trop petit. Dans cet univers totalement inconnu, il fait « peau neuve » au propre comme au figuré « Il faut juste laisser les vieilles mues tomber ». Pourtant, tout au long du récit, le cas irrésolu de Lucie F. devient pesant, voire obsessionnel et résonne à ses yeux comme un échec.
« La patience des traces », au titre évocateur, est un roman d’apprentissage lentement tissé, un peu comme ces anciens tissus Bingata japonais. Une fois encore, Jeanne Benameur nous accompagne dans une quête de l’essentiel avec ce récit profond et poétique où les rencontres conjuguées aux traditions sont déterminantes et agissent comme de véritables révélateurs. Comme l’auteure se plaît à le dire « on a toujours l’espérance quand on écrit de pouvoir éclairer aussi un peu, un temps, des vies qui cherchent à travers la lecture, quelque chose » « la psychanalyse et la poésie, c’est proche, non ? ».
Éditions ACTES SUD
60-62, avenue de saxe
75015 PARIS
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT
De Leïla SLIMANI
Éditions Stock
Leïla Slimani nous entraîne dans une balade introspective nocturne au Musée d’art contemporain de la Punta della Dogana, monument mythique de Venise. L’ancienne Douane de mer donnant sur la lagune « ressemble à un bateau brise-glace, avec sa proue pointue / On dirait que le bâtiment va se mettre à glisser sur l’eau ». Son récit, où se mêlent souvenirs d’enfance et rêveries, est court mais dense. Elle va vivre l’expérience de la claustration « Je m’apprête à être enfermée / pour une fois je n’ai pas peur / Moi, c’est le dehors qui me fait peur ». Pour autant, elle ne se sent pas impliquée dans cet univers qui lui semble sibyllin « Les musées continuent de m’apparaître comme des lieux écrasants, des forteresses / où je me sens toute petite / un espace élitiste dont je n’ai toujours pas saisi les codes ». Portée par la magie de la nuit, l’insomnie et le silence, elle se laisse envahir peu à peu par l’émotion que lui inspirent les œuvres qui l’entourent. Elle nous livre son regard sur « les œuvres dites conceptuelles ». Les références littéraires et artistiques nombreuses dans l’ouvrage viennent subtilement étayer le propos de l’auteure. La poétesse et peintre libanaise, Etel Adnan, est très présente dans cette exposition intitulée « Luogo e Segni » (Lieu et signes).
Au détour d’une nuit blanche où règne l’incertitude, nous pénétrons l’intimité de Leïla Slimani qui privilégie la solitude au mouvement perpétuel. Dans cette bulle hors du temps, réminiscences et réflexions révèlent une part de nostalgie qui ramène immanquablement l’auteure à la figure vénérée de son père, injustement condamné et emprisonné. Le rideau s’ouvre sur son parcours de femme et d’écrivain mais aussi sur les plaies ouvertes. Elle fait parler les silences et les mots donnent corps aux fantômes. Nous nous laissons porter au gré de ses marées intérieures entre passé et présent, Orient et Occident, mirages et réalité. Paradoxalement, l’enfermement, loin du bouillonnement du monde, devient une source d’évasion. L’écriture détient ce potentiel émancipateur de libérer des peurs, des fantasmes et de l’ennui.
« Écrire c’est découvrir la liberté de s’inventer soi-même et d’inventer le monde ». S’épanouir loin du tumulte extérieur comme ces fleurs de datura qui ne s’ouvrent que la nuit et exhalent leur parfum puissant à l’abri des regards. Se laisser bercer par les vagues olfactives du galant de nuit, appelé aussi « mesk el arabi », arbre évocateur de l’enfance à Rabat au Maroc.
En déambulant, pieds nus dans ce lieu désert, chargé de mystère, Leïla Slimani tisse l’imaginaire et le réel et nous livre un ouvrage empreint de poésie aux allures de viatique. Cet hymne à la liberté et à la création est une sorte de miroir où bon nombre d’entre nous pourront se retrouver, un livre bouleversant, profond et sensible à l’image de son auteure.
Éditions STOCK
21, rue du Montparnasse
75006 PARIS
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L’ENFANT THÉRAPEUTE
DE SAMUEL DOCK
Éditions Plon
Dans « l’enfant thérapeute », un témoignage absolument poignant, Samuel Dock nous fait don de sa propre histoire, un coup de cœur qui mérite une place hors norme tant il ressemble à un tsunami. Pour pouvoir faire le deuil de son enfance, il doit avant tout faire celui de l’enfance de sa mère, Béatrice, qui a vécu sévices, privations et humiliation par le passé. Cet ouvrage est un rude face à face avec une implacable réalité qui, souvent, est de l’ordre de l’insoutenable. Samuel nous livre les éléments qui composent sa vie et, autant dire que les mots dérangent, interrogent. Nous sommes à ses côtés dans une attente viscérale de la vérité et ce, au prix d’un déchirement intérieur d’une grande violence.
À l’adolescence, il est confronté à l’abandon du père, l’anorexie de sa sœur et les dérives qui entraînent celle-ci dans des paradis artificiels, monopolisant alors toute l’énergie d’une mère tourmentée et totalement dépassée, ce qui rompt les liens familiaux déjà fragiles « il me semble que je vais me casser en deux » « il y a trop de poids sur mes épaules, le poids des choses anciennes ». Prisonnier d’une cage de solitude, en proie à la dépression, Samuel affronte de multiples déceptions en se confiant à ses carnets, témoins silencieux de son mal-être, jour après jour « infernal cordon ombilical de douleur et de mort, il me faut le couper ». Il parvient à s’extraire de cet univers où il est devenu invisible « La misère véritable, ce n’est jamais la pauvreté, c’est celle d’un cœur désert ». Encore faut-il pouvoir couper les ponts pour pouvoir survivre !
Adulte, devenu psychothérapeute, il donne de la voix pour que les victimes de maltraitance soient entendues, tout particulièrement les enfants. Il mène une quête éperdue pour que la dignité et l’humanité ne soient plus seulement des mots. Il accompagne « des gamins cassés, brisés par leurs familles ».
Alors qu’il s’est éloigné de la sienne pour se reconstruire, Samuel découvre le passé de sa mère dans le journal qu’elle a tenu à lui adresser. Ce douloureux récit a pour but de mettre enfin des mots, sans retenue sur tant de non-dits et faire parler sans tabous les fantômes du passé. À l’âge de cinq ans, Béatrice, sa mère, est confiée à la DDASS, couverte de morsures et affamée. Placée dans un institut religieux, la fillette meurtrie retrouve peu à peu des repères, découvre le sens du mot bienveillance et peut à nouveau se réapproprier celui d’espoir. Mais la maltraitance laisse inévitablement ses stigmates.
Il faudra des années de souffrance et de questionnement entre la mère et le fils pour réapprendre à se parler, tenter de concilier passé et futur, peser les mots. Mais peut-on vraiment rattraper le temps perdu « tout ne peut pas être guéri, tout ne peut pas être pardonné ». C’est bien notre enfance qui détermine l’adulte que nous allons devenir. Endosser le rôle de l’enfant thérapeute, relève de l’impossible et cependant, Samuel Dock ne cesse de s’y employer, secondé par son âme sœur, la personne qui partage sa vie et lui apporte un soutien indéfectible.
Samuel Dock, l’homme qui murmure à l’oreille de l’enfant en chacun de nous, vient de sa plume généreuse baignée dans l’encre vive, déloger nos doutes et recoudre toutes les parties d’un puzzle que l’on croyait éparpillées à jamais « Les mots, l’écoute, au bon moment, ils peuvent sauver » !
Contact : Éditions Plon
92, avenue de France
75013 PARIS
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
UNE MÈRE
LE CRI RETENU
de Pierre PERRIN
Ce livre, paru tout d’abord en 2001, vient d’être réédité en 2022 et nous offre l’opportunité de faire un voyage introspectif avec Pierre Perrin, poète, romancier et critique littéraire.
L’auteur vient chercher sur la rugosité de la page blanche une terre d’asile pour accueillir sa douleur incommensurable et réponses aux questions suspendues dans les méandres du temps, là où le mutisme maternel prend ses aises. « je reste le cœur dévoré d’incertitudes ». La mère disparue et pourtant si présente, occupe tout l’espace, d’un silence pesant. Au fil des pages, Pierre Perrin va gratter du bout des doigts, à s’en écorcher, la terre natale pour exhumer un souffle de vie car « Le voile de l’oubli pèse plus qu’un linceul »…« au-delà des dahlias hauts comme des flammes », il faut écarter tout ce qui peut brûler la moindre parcelle d’espérance.
Emprunter le chemin à l’envers et retrouver le « chien trop aimé », devenu complice de jeu, cet animal, frère de misère, abattu d’un coup de hache, ce qui assènera un traumatisme irréversible à l’enfant de dix ans « puisqu’il faut compter les dépenses au centime près ». Se demander si l’embrasement des étés de l’adolescence permet d’apaiser les incandescences qui vous réduisent en cendres si vous n’y prenez garde. D’une lucidité criante, l’interrogation surgit : le temps nous réduit-il à l’impuissance des regrets « Le temps, c’est Attila – au galop et au repos ».
L’éveil se fraie un chemin de hasard dans les labyrinthes d’un parcours parfois chaotique et notre approche s’en trouve chahutée. D’un bois tendre, il faut tenter, bon gré, mal gré d’accepter les blessures gravées sur l’écorce de notre vie « Maman permets-moi de te comprendre, par-delà ta mort ». La vie rude et laborieuse du monde rural ne laisse pas de place aux élans de tendresse maternelle. Dans sa quête éperdue, l’auteur ébauche inlassablement des étreintes qui se dérobent, mirages de papier, « La vie se passe à appeler un bonheur qui recule à mesure qu’on l’approche ». Il fouille la cicatrice de son enfance, restée béante, pour recoudre avec les fils du passé et du présent, ce qui peut être « réparé » « Du plus loin que je me souvienne, j’attendais d’être aimé ».
Avec ce « cri retenu », Pierre Perrin nous fait pénétrer son intimité et ses déchirements aux accents de confession. Même si « la littérature…ne peut rien contre la mort » « l’amour est presque aussi fort que la mort ». La virtuosité du verbe, telle une corde tendue, confère une valeur holistique à cet ouvrage bouleversant qui vient bousculer les certitudes les plus « encrées ».
Contact : Le Cherche midi Éditeur
92, avenue de France
75013 PARIS
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
GARDER VIVANTE LA FLAMME DU POÈME
d’Éric CHASSEFIÈRE
Ce nouveau recueil d’Éric Chassefière, préfacé par Annie Briet, est une plongée introspective dans le silence si souvent salvateur qui nous ouvre une fenêtre sur le vrai, l’essentiel, ce qui est de nature à nous révéler à nous-mêmes. La beauté du monde est à portée de mots… « La fenêtre qu’on ouvre est celle de la page ». Le poète affûte alors son regard, retient son souffle pour capter l’invisible et percevoir le moindre chant d’oiseau. On pénètre son jardin comme un livre dont on tourne les pages une à une : fruit de l’imaginaire ou réalité… qui sait ? L’oiseau se pose entre les lignes « au fil d’encre du poème ». Tout un registre lexical empreint de douceur et de tendresse propre à l’auteur, devient matériau entre ses mains, qu’il caresse, pétrit inlassablement et façonne comme de la glaise.
Le silence « éclairant les mots » et décliné de nombreuses fois dans ses poèmes nous permet de sentir jusqu’à la respiration qui anime l’auteur « ouvrir les mains / boire à la source / sentir comme tout vit / comme la joie respire ».
Toutes les pages à venir sont emplies d’un mystère qui reste à découvrir. Ses encres se mêlent, tantôt sombres, tantôt allègres.
Poète funambule, Éric Chassefière, guidé par sa « lampe allumée » avance pour « ne pas perdre le cap », pour « garder l’équilibre » et « garder vivante la flamme du poème ».
il ne sait plus où il va
tout chemin en ce lieu est recommencement
il cherche par l’écriture une plénitude à sa vie
Marie-Christine Guidon
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LES GISANTS DE L’ÂME
de Christian BOESWILLWALD
Poèmes et photographies du deuxième confinement
Christian Boeswillwald fait souffler sur son recueil un vent de révolte : le refus de la situation ubuesque imposée par le virus ravageur qui sévit depuis de longs mois, une gestion inique de la part des différentes institutions en place et le refus d’être inféodé. L’homme aux multiples soleils, parfois ombrés de désespoir, jette l’encre dans cet océan qu’est l’humanité « J’écris comme un oiseau affamé de soleil » « Qu’attendre du soleil que l’ombre de la lune / Quand viendra le désespoir / Et qu’il sera trop tard ».
L’auteur prend son bâton de pèlerin-poète pour « dénoncer la mise sous cloche de notre vie d’humain ». Son regard est celui d’un être d’une sensibilité exacerbée où tous les sens et les émotions sont mobilisés. Son cri ne peut laisser indifférent alors que la peur et le doute viennent habiller l’horizon d’un voile sépulcral « Qu’importe ce monde qui choisit la Mort plutôt que la Vie, le poids des secondes sans la Poésie » « Vieillir est un privilège d’enfant ».
Le poète nous offre de belles pages où la nature qui lui est chère apporte l’apaisement comme un phare dans la tempête en nous laissant entrevoir une lueur d’espérance, malgré tout… « Demain l’oiseau d’exil reviendra dans les branches ».
Cet ouvrage « Les gisants de l’âme » dresse un bilan sans concession aux accents nostalgiques, au parfum de regrets « Entends-tu cette chanson triste / Qui passe comme la jeunesse » « Où étais-tu toute ta vie ? »
Les arbres omniprésents sur les photographies qui ponctuent les poèmes sont la preuve en images de l’enracinement profond de Christian Boeswillwald en terre de Poésie.
Marie-Christine Guidon
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
REVENIR À TOI
de Léonor de RÉCONDO
Redire « Maman », après trente ans de silence !
Magdalena, 44 ans, actrice reconnue, reçoit un message de son agent lui annonçant qu’on a retrouvé sa mère Apollonia, disparue 30 ans plus tôt. Cette dernière vit dans une maison éclusière en bordure de canal dans le Lot et Garonne. Dépressive, Apollonia a quitté un jour la maison mais on n’en parle pas, le sujet est tabou. « Maman est tombée dans le silence de l’absence ». Alors, Magdalena a trouvé un refuge dans le théâtre « C’est dans cette communion qu’elle est tout à fait vivante » « Elle appelle Sophocle à l’aide quand sa pensée est paralysée par une émotion qui la submerge ». C’est déjà Antigone qui l’a sauvée en classe de 3ème « pas celle de Sophocle, non, celle d’Anouilh ». Des années plus tard, le théâtre dispense encore pour elle ses vertus cathartiques. « Revenir à toi » est un hommage aux mythes littéraires qui nous structurent et Magdalena va être le porte-parole d’Antigone.
Que de fois, elle avait espéré que la notoriété inciterait sa mère à l’appeler. Il lui était aussi arrivé d’imaginer sa mère morte « Puis l’image se désintégrait par la grâce de l’oubli ». Magdalena va se réapproprier son histoire à travers le voyage pour retrouver Apollonia « Ses pas l’entraînent du passé au présent ». À son arrivée, elle est tétanisée et « se recroqueville autour de la brisure de son enfance, se racornit autour de son angoisse » et découvre un lieu qui « ressemble plus à une décharge qu’au Pays des Merveilles ». Elle se heurte de nouveau à un mur de silence, face à sa mère mutique. Pourtant, dans un long monologue, Magdalena confesse « ce serait trop simple de réduire mes échecs à ton départ ». Retrouver l’Autre à tout prix pour mieux se retrouver soi-même. Une grande violence et une souffrance incommensurable sont perceptibles dans les non-dits. En marge de tous ses questionnements, le périple permet à Magdalena de vivre une parenthèse amoureuse qui apporte une touche de sensualité et de légèreté dans un contexte d’incomplétude.
Dans ce roman, toutes les temporalités se percutent. La plume de Léonor de Récondo, également violoniste renommée, fera vibrer la corde sensible de tous les lecteurs réceptifs à son récit intimiste.
Éditions GRASSET
61, rue des Saints-Pères
75006 PARIS
Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
DANS LES FÊLURES DU TEMPS
D’Antoine LEPRETTE
La Maison du Pêcheur-Locmiquélic, est un étrange endroit où « le Temps est tout sauf linéaire » et dans ses fêlures, Antoine Leprette nous fait affronter, de plein fouet, bien des tempêtes intérieures. Le temps aurait-il dérapé ou bien serait-ce l’homme brisé par ses nuits d’insomnie ?
La poésie de l’auteur, libérée des gangues de la prosodie, se livre sans faux-semblants dans ce premier recueil. Les illustrations couleur, format A 4, de Behi et Titouan, tous deux Iraniens, contribuent à nous faire pénétrer dans les rouages tourmentés d’un poète-explorateur du Temps. Elles viennent souligner les désirs, les doutes, mais aussi le désarroi face à l’inacceptable et l’extrême solitude que les mots, seuls, ne parviennent pas toujours à exprimer. À noter, chose assez inhabituelle pour être mentionnée, que l’ouvrage a été traduit en farsi par Maryam Shariavi.
Au-delà de la course folle des aiguilles où, passé, présent et futur se heurtent sans cesse « Le temps prend son dû / sauvagement » et « Les vertiges les plus étourdissants » finissent par se figer en de lointains souvenirs. Cet arrêt sur image sonne l’heure d’une prise de conscience aux parfums de regrets « Le temps de l’enfance perdu à jamais / suspendu au bout de la mémoire » « Nous contemplons avec terreur ce monde détruit / tout est dévasté », ce que vient corroborer un écho rimbaldien dans « Le dormeur sur sa table » « noyé dans ses trous noirs / Il dort ». Mais, d’un battement d’ailes, la vie reprend son bouillonnement, malgré l’absence, puisqu’il nous faut « renaître chaque jour précieusement »…
Antoine Leprette, face à l’inéluctable voie sans issue nous livre ses impressions sur le surgissement de la Vie en toute chose… « Mes morts ne sont pas morts, ils sont dans l’air du Temps / emportés par les vents, ils sont graines et semences / ils colorent mes rêves d’un passé enchanté ». À l’évocation de la femme aimée, symbolisée par la rose qui se meurt : « J’aime à penser que je pourrai…te sentir dans les airs », confie le poète, sans doute pour grappiller ce qu’il reste encore de souffle « un coquillage sur l’oreille ».
Malgré les frontières invisibles ou bien réelles qui emprisonnent et conduisent à l’arrachement, laissant « un vide, un manque", « Tant que nous serons vivants / Nous aimerons l’amour, les femmes et les enfants / Les glaces à la vanille et les mistrals gagnants » …Une dernière seconde de certitude du poète « J’ai mis mes pieds d’adulte dans mes chaussures d’enfant / Et j’ai fermé les yeux pour ce voyage ailé / Enfin réconcilié ! »
Contact : Antoine LEPRETTE
46, Grande Rue
56570 LOCMIQUÉLIC
antoine@leprette.fr Marie-Christine GUIDON
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ajouter un commentaire